« Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts », affirmait le Général de Gaulle. Cette maxime illustre parfaitement la politique étrangère des États-Unis d’Amérique (« USA »), qui, malgré leur image de protecteur et d’allié de la France, ont à plusieurs reprises poursuivi leurs propres intérêts au détriment de ceux de leur supposé partenaire.
Si l’histoire officielle tend à mettre en avant le rôle des Américains dans la libération de la France en 1944 et à les présenter comme un allié indéfectible, la réalité est plus nuancée. De nombreux événements, occultés ou minimisés, révèlent une relation bien plus pragmatique, marquée par la méfiance, la concurrence et parfois même l’hostilité.
L’un des épisodes les plus méconnus mais révélateurs de cette réalité est le projet américain de placer la France sous occupation militaire après la Seconde Guerre mondiale, au même titre que l’Allemagne vaincue. Ce plan, connu sous le nom d’AMGOT (« Allied Military Government of Occupied Territories »), illustre comment, derrière le discours de la libération, se dissimulaient des ambitions hégémoniques.
À travers une relecture critique des relations franco-américaines, nous mettons en lumière les tensions, les rivalités et les intérêts divergents qui ont jalonné l’histoire commune des deux nations.
Table des matières
1. Une amitié illusoire : la réalité des relations franco-américaines
Ce paradoxe résulte en grande partie du soft power dans lequel excellent les USA et d’un travestissement de la réalité de l’histoire avec l’assentiment et la participation active de notre propre pays.
Tel est notamment le cas lorsque l’importance de la lutte menée par l’URSS contre l’Allemagne pendant la seconde guerre mondiale est passée sous silence au bénéfice des USA. Les dirigeants de notre pays se complaisent à enseigner à la population des données incomplètes et erronées, que ce soit lors des études ou d’autres façons notamment par les médias.
2. La France, un dommage collatéral des intérêts américains
Historiquement, les relations entre les USA et la France n’ont pas été empreintes de fidélité ou d’amitié véritable. Les États-Unis agissent en fonction de leurs intérêts et se tiennent prêts à sacrifier la France si nécessaire, à l’instar d’autres pays. Nikola Mirkovic dans son livre « L’Amérique Empire » (Nikola Mirkovic, L’Amérique Empire, Temporis, 2021) dévoile la réalité derrière le masque plaisant dont les USA se parent.
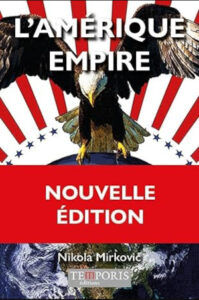
Si nous revenons nous concentrer plus particulièrement sur l’attitude des USA envers la France il faut se souvenir de l’actualité relativement récente avec la crise des sous-marins australiens où les USA épaulés par le Royaume-Uni ont, en 2021, fait échouer le contrat passé entre la France et l’Australie pour la fourniture par Naval Group à la Royal Australian Navy de douze sous marins de la classe Attack.
Parallèlement à l’annulation de cette commande le 15 septembre 2021 l’Australie a rendu public l’accord Aukus. Cet accord tripartite avec ce pays, les USA et le Royaume-Uni prévoit notamment l’acquisition par l’Australie d’au moins huit sous marins nucléaires d’attaques de la classe Virginia, et donc de technologie américaine.
Ainsi les intérêts américains et britanniques ont prévalu au détriment du contrat franco-australien initialement conclu.
3. Une hostilité historique : quand les USA et le Royaume-Uni privilégiaient l’Allemagne
La duplicité des USA et du Royaume-Uni n’est pas une nouveauté. Au contraire elle persiste depuis longtemps et illustre leur volonté récurrente de nuire à la France, même au-delà des considérations financières. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont des récidivistes en la matière à tel point qu’ils avaient planifié dans le passé la destruction de la France, même en dehors des époques lointaines des guerres les ayant opposés.
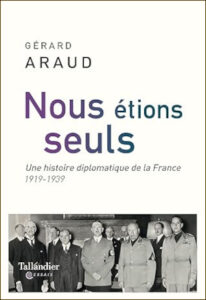
Entre les deux guerres mondiales, aussi bien les USA que le Royaume-Uni se méfiaient de la France et donnaient préférence à… l’Allemagne, avec la réussite que l’on connaît vu que cette folie a participé à la survenance de la seconde guerre mondiale.
Cette période de l’entre deux guerres est particulièrement bien documentée dans le livre passionnant de Gérard Araud intitulé « Nous étions seuls » (Gérard Araud, Nous étions seuls, Tallandier, 2023). Comme il l’a lui-même déclaré en reprenant une expression fameuse : « Quand on a de tels alliés, on n’a pas besoin d’ennemis ! »
4. Le projet secret d’occupation de la France après 1945
La duplicité des USA et du Royaume-Uni semble être sans limite. Ainsi tous deux souhaitaient achever la France au sortir de la seconde guerre mondiale, et ce n’est que grâce au Général de Gaulle que ce projet démoniaque a été avorté. Le Général nous aura ainsi successivement sauvés des Allemands, mais aussi des USA et du Royaume-Uni
5. L’AMGOT : un plan américain pour gouverner la France
En effet, sous l’impulsion principale des USA, ces deux derniers pays désiraient mettre la France sous protectorat américain, à l’instar des pays vaincus, Allemagne, Italie et Japon.
Le président américain Franklin Delano Roosevelt, qui détestait la France et en particulier le Général de Gaulle, avait prévu l’instauration en France d’un gouvernement militaire allié des territoires occupés, plus connu sous le terme « AMGOT » pour « Allied Military Government of Occupied Territories ».
Ce gouvernement devait être un gouvernement militaire d’occupation, constitué d’officiers américains et britanniques. La monnaie française devait être remplacée par une monnaie dont les billets seraient imprimés par la Réserve fédérale des États-Unis, certains ont d’ailleurs circulé pendant un temps. La France devait être démembrée et perdre l’Alsace-Lorraine et les Hauts-de-Seine.
Ce plan odieux avait été forgé de longue date, bien avant la libération, alors que la guerre faisait rage. Ainsi en novembre 1942 Roosevelt déclarait à André Philip « quand nous entrerons en France, nous userons du droit de l’occupant » (Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France libre : de l’appel du 18 juin à la Libération, Gallimard, 1996). Le 08 mai 1943 Roosevelt écrivait à Winston Churchill : « Je suis enclin à penser que lorsque nous serons en France, il faudra considérer notre action comme celle d’une occupation militaire gérée par des généraux Américains et Britanniques (…). Les postes les plus importants, l’administration nationale, doit être gardée entre les mains du commandant-en-chef Britannique ou Américain » (Charles L. Robertson, When Roosevelt planned to govern France, University of Massachusetts Press, 2011). À terme des élections devaient être organisés. Dans l’hypothèse où elles auraient été effectivement organisées, ce qui est loin d’être certain, vu la personnalité de Roosevelt il est à craindre qu’elles l’auraient été pour obtenir l’élection d’hommes la main des USA.
Pour en savoir davantage sur les aspects sombres de la libération de la France par les forces alliées, découvrez un article de notre blog, qui dénonce le traitement inacceptable réservé aux femmes françaises par les militaires américains lors de la libération. Un épisode tragique et souvent minimisé de notre histoire, où des violences inouïes ont été infligées à une partie de la population française, dans un contexte de « libération » qui s’est avéré bien plus complexe et douloureux qu’il n’y paraît. Vous trouverez cet article ici : le traitement des femmes françaises par des militaires américains lors de la libération.
6. De Gaulle, le rempart contre la mise sous tutelle de la France
Nous devons à Charles de Gaulle d’être parvenu à arrêter, entre le 04 et le 14 juin 1944, ce plan démoniaque, qui rencontrait également des oppositions aux USA et au Royaume-Uni. Ainsi, concernant ce dernier pays, Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, écrivait le 04 mars 1944 dans son journal que les Britanniques seraient « fous de suivre Roosevelt, aveuglé par son aversion absurde et mesquine pour de Gaulle » (Eric Branca, L’ami américain, Perrin, 28 avril 2022).
Alain Peyrefitte citera ultérieurement Charles de Gaulle en ces termes pour expliquer son refus de célébrer le débarquement de Normandie : « Le débarquement du 6 juin, ç’a été l’affaire des Anglo-Saxons, d’où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s’installer en France comme en territoire ennemi ! Comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s’apprêtaient à le faire en Allemagne ! Ils avaient préparé leur AMGOT qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l’avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie, qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis… Et vous voudriez que j’aille commémorer ce débarquement qui était le prélude à une seconde occupation du pays ? » (Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, Fayard, 1994).
7. L’indépendance de la France, un combat permanent
Loin du récit idyllique d’une alliance indéfectible entre la France et les États-Unis, l’histoire révèle une relation empreinte de calculs stratégiques et d’intérêts divergents. L’AMGOT, projet visant à placer la France sous administration militaire américaine, incarne cette volonté hégémonique qui aurait pu réduire notre pays au rang de simple territoire occupé, au même titre que les nations vaincues.
Si ce plan n’a jamais vu le jour, c’est grâce à la détermination du Général de Gaulle, qui a su imposer la souveraineté française face aux ambitions américaines et britanniques. Mais au-delà de cet épisode, c’est toute la dynamique des relations franco-américaines qui interroge : entre soutien intéressé et trahisons déguisées, les États-Unis ont toujours agi selon leurs propres intérêts, quitte à affaiblir un allié historique.
Comprendre cette réalité, c’est prendre conscience de l’importance de défendre une politique indépendante, à l’abri des illusions d’amitié inconditionnelle. Car comme l’histoire l’a montré à maintes reprises, en géopolitique, les alliances ne sont jamais acquises : elles ne sont que le reflet des rapports de force du moment.
8. Pour aller plus loin : sélection de livres incontournables
Pour approfondir les sujets abordés dans cet article et mieux comprendre les enjeux historiques des relations franco-américaines, voici une sélection d’ouvrages essentiels :
• Nous étions seuls – Gérard Araud. Un livre captivant qui explore l’isolement diplomatique de la France face aux stratégies anglo-saxonnes entre les deux guerres mondiales. Découvrir sur Amazon.
• La France libre : de l’appel du 18 juin à la Libération – Jean-Louis Crémieux-Brilhac. Un ouvrage de référence qui retrace le combat de la France libre et les tensions entre De Gaulle et ses alliés supposés. Découvrir ce livre sur Amazon.
• L’ami américain – Eric Branca. Une analyse percutante des relations ambiguës entre la France et les États-Unis, entre soutien apparent et calculs stratégiques. Découvrir ce livre sur Amazon.
• C’était de Gaulle – Alain Peyrefitte. Un témoignage fascinant sur la vision du Général de Gaulle et sa lutte pour préserver l’indépendance de la France face aux influences étrangères. Découvrir ce livre sur Amazon.
• L’Amérique Empire, de Nikola Mirkovic. Un regard sans concession sur l’influence américaine dans le monde et son impact sur les nations alliées, dont la France. Découvrir ce livre sur Amazon.
9. Points à retenir
• Les relations franco-américaines sont marquées par des intérêts divergents plutôt que par une véritable amitié.
• Le rôle des États-Unis dans la libération de la France en 1944 est souvent idéalisé, occultant des aspects plus pragmatiques et stratégiques.
• Le projet AMGOT visait à placer la France sous administration militaire américaine après la Seconde Guerre mondiale.
• Franklin D. Roosevelt nourrissait une hostilité marquée envers la France et le Général de Gaulle.
• Le Royaume-Uni et les États-Unis ont historiquement favorisé l’Allemagne plutôt que la France entre les deux guerres mondiales.
• L’annulation du contrat des sous-marins australiens en 2021 illustre la priorité donnée par les États-Unis à leurs propres intérêts économiques et stratégiques.
• Charles de Gaulle a joué un rôle déterminant pour préserver l’indépendance et la souveraineté de la France face aux pressions américaines et britanniques.
• L’histoire démontre que la France ne peut compter que sur elle-même pour garantir sa souveraineté et défendre ses intérêts.
10. Liens utiles
• Sur le site du Courrier International : la France humiliée dans la crise des sous-marins nucléaires.
• Sur Wikipedia : le Gouvernement de la France par l’armée des USA.
